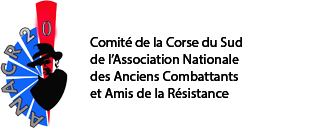Dans ses mémoires publiées aux Editions du Rocher, sous le titre « Panzers sur l’Europe », le Général Von Senger und Etterlin fait le récit de l’évacuation vers l’Italie des troupes allemandes présentes en Corse -celles déjà présentes et celles venant de Sardaigne, quelque 30.000 hommes
 Je ne dirai pas que j’ai accueilli avec un enthousiasme particulier la mission, qui me fut confiée début septembre, de diriger, en qualité de commandant de la Wehrmacht dans ces îles, l’évacuation de la Sardaigne et la défense de la Corse. Pour cela, mes souvenirs de Sicile étaient par trop mitigés. Les perspectives étaient encore plus mauvaises. Entre-temps, la situation politique avait empiré. L’OKW (1) traitait le gouvernement Badoglio avec une morgue grossière, tandis que les personnes douées d’un certain sens diplomatique, tel l’attaché militaire de Rome, préconisaient la recherche d’un modus vivendi, quoiqu’elles connussent l’attitude de ce gouvernement. Je devais m’attendre à être lâché par nos alliés dans ces îles, et cette perspective n’avait rien de réjouissant. L’OBS avait prescrit, dans ce cas, de désarmer immédiatement les Italiens. Mais pour cela les forces allemandes stationnées dans ces îles étaient par trop inférieures en nombre. Il fallait aussi s’attendre à voir des rebelles français autochtones s’en mêler. Et pour finir, la menace d’un débarquement allié se précisait. Un saut sur ces îles, en partant de la Sicile, donnerait aux Alliés une base pour des débarquements de grande envergure dans le dos des forces allemandes du continent. Même du seul point de vue géographique, ces îles étaient plus isolées que la Sicile. Elles sont presque aussi distantes du continent que la Sicile de l’Afrique. À cela s’ajoutait la supériorité aérienne et navale des Alliés. La mission de défendre des îles aussi isolées me paraissait constituer un nouvel exemple de notre méconnaissance de l’importance de la mer et de l’air dans des opérations modernes. Cette mission ne me semblait pas devenir plus sensée du fait qu’elle ne consisterait, en cas de défection des Italiens, qu’à faire passer la garnison allemande de Sardaigne en Corse pour défendre cette seule île. Les Alliés n’assisteraient certainement pas les bras croisés au rassemblement des forces d’occupation des deux îles ; et, tôt ou tard, la Corse leur reviendrait fatalement.
Je ne dirai pas que j’ai accueilli avec un enthousiasme particulier la mission, qui me fut confiée début septembre, de diriger, en qualité de commandant de la Wehrmacht dans ces îles, l’évacuation de la Sardaigne et la défense de la Corse. Pour cela, mes souvenirs de Sicile étaient par trop mitigés. Les perspectives étaient encore plus mauvaises. Entre-temps, la situation politique avait empiré. L’OKW (1) traitait le gouvernement Badoglio avec une morgue grossière, tandis que les personnes douées d’un certain sens diplomatique, tel l’attaché militaire de Rome, préconisaient la recherche d’un modus vivendi, quoiqu’elles connussent l’attitude de ce gouvernement. Je devais m’attendre à être lâché par nos alliés dans ces îles, et cette perspective n’avait rien de réjouissant. L’OBS avait prescrit, dans ce cas, de désarmer immédiatement les Italiens. Mais pour cela les forces allemandes stationnées dans ces îles étaient par trop inférieures en nombre. Il fallait aussi s’attendre à voir des rebelles français autochtones s’en mêler. Et pour finir, la menace d’un débarquement allié se précisait. Un saut sur ces îles, en partant de la Sicile, donnerait aux Alliés une base pour des débarquements de grande envergure dans le dos des forces allemandes du continent. Même du seul point de vue géographique, ces îles étaient plus isolées que la Sicile. Elles sont presque aussi distantes du continent que la Sicile de l’Afrique. À cela s’ajoutait la supériorité aérienne et navale des Alliés. La mission de défendre des îles aussi isolées me paraissait constituer un nouvel exemple de notre méconnaissance de l’importance de la mer et de l’air dans des opérations modernes. Cette mission ne me semblait pas devenir plus sensée du fait qu’elle ne consisterait, en cas de défection des Italiens, qu’à faire passer la garnison allemande de Sardaigne en Corse pour défendre cette seule île. Les Alliés n’assisteraient certainement pas les bras croisés au rassemblement des forces d’occupation des deux îles ; et, tôt ou tard, la Corse leur reviendrait fatalement.
Le 7 septembre, un DO 217 m’amena à Ajaccio. L’état-major avait déjà été mis en route via Livourne. Je me présentai au VIlème corps d’armée italien à Corte. Le général Magli, commandant le corps d’armée, passait pour germanophile, ayant collaboré avec Cavallero. C’est pourquoi Kesselring le connaissait et l’estimait. Mais, parmi les officiers, je trouvai l’atmosphère glaciale. Le feld-maréchal Kesselring pensait pouvoir compter sur une « collaboration loyale » de la part de Magli. Cela rendait particulièrement difficile ma mission politique, parallèle à ma mission militaire. Ni le feld-maréchal, ni l’OKW hitlérien ne comprenaient qu’un officier italien pût se trouver placé dans la situation d’avoir à exécuter les ordres de son gouvernement légitime, ordres qui pouvaient fort bien avoir pour objet de déposer les armes. Car il faudrait bien un jour qu’une telle décision mît fin à cette guerre. Telles que les choses se présentaient, un pareil ordre ne pouvait être donné que dans le dos des Allemands. Mais cet arrière-goût de « trahison » ne devait pas empêcher les hommes d’État de s’engager dans cette voie pour sauver leur peuple. Et les officiers, dans ce cas, n’avaient qu’à obéir. Je ne fus donc pas surpris du refus que m’opposa le général Magli, comme il l’avait déjà fait auparavant, de laisser occuper ses batteries côtières par du personnel allemand, ainsi que l’avait demandé Kesselring. Cette exigence, à ses yeux, était humiliante et ne pourrait que nuire au moral élevé de ses troupes. Le général Magli avait quatre divisions. Moi, par contre, je ne disposais, en Corse même, que des forces insignifiantes : la brigade d’assaut SS « Reichsführer SS » qui, pour toute infanterie, ne comptait que deux bataillons, était assez forte en artillerie et possédait un bataillon de chasseurs de chars. La brigade était rassemblée au sud autour de Sartène afin de s’y opposer à d’éventuelles tentatives de débarquement ennemi, ou, le cas échéant, permettre un retrait des troupes allemandes de Sardaigne en formant une tête de pont à Bonifacio. Le bataillon de chasseurs de chars était installé à Porto Vecchio. Le VIlème corps d’armée italien avec ses quatre divisions avait à sa charge tout le reste de la défense. J’y fus affecté comme chef de l’état-major de liaison, par analogie avec ma mission en Sicile.
 J’étais d’accord avec l’état-major du corps d’armée sur un point, c’est que toute la côte Est semblait menacée. Les divisions italiennes étaient groupées de telle façon qu’elles ne pouvaient défendre que la côte Ouest. Mais un débarquement par surprise sur la côte Est paraissait parfaitement possible et promettait d’être payant. Il aurait pu couper de l’important port de Bastia les forces allemandes stationnées dans le Sud, où elles se trouveraient bloquées. J’avais, par conséquent, l’intention, en cas de défection des Italiens, d’aligner le long de la côte est les éléments de la 90e division de grenadiers blindés qui arriveraient de Sardaigne, afin de rétablir une liaison entre la pointe sud et Bastia. Le général Magli approuva ce plan. Il voulait, en cas de débarquement sur la côte Est, participer à la défense par des contre-attaques partant de l’intérieur de l’île (!). À Bastia même, la situation était particulièrement défavorable. Il s’y trouvait trois batteries de DCA et quelques services allemands : un officier de garnison, l’important service des transports maritimes, le chef du ravitaillement de la Wehrmacht et quelques petites unités administratives. Un bataillon allemand arrivé en renfort dut être immédiatement employé pour moitié à la garde des dépôts. Cela libérait quelques équipes de servants pour les batteries côtières, que j’avais l’intention d’engager à la place du personnel italien, en cas de déroulement favorable à Bastia et à Bonifacio. D’ailleurs, il y avait à Bastia même et dans ses environs immédiats l’une des quatre divisions italiennes !
J’étais d’accord avec l’état-major du corps d’armée sur un point, c’est que toute la côte Est semblait menacée. Les divisions italiennes étaient groupées de telle façon qu’elles ne pouvaient défendre que la côte Ouest. Mais un débarquement par surprise sur la côte Est paraissait parfaitement possible et promettait d’être payant. Il aurait pu couper de l’important port de Bastia les forces allemandes stationnées dans le Sud, où elles se trouveraient bloquées. J’avais, par conséquent, l’intention, en cas de défection des Italiens, d’aligner le long de la côte est les éléments de la 90e division de grenadiers blindés qui arriveraient de Sardaigne, afin de rétablir une liaison entre la pointe sud et Bastia. Le général Magli approuva ce plan. Il voulait, en cas de débarquement sur la côte Est, participer à la défense par des contre-attaques partant de l’intérieur de l’île (!). À Bastia même, la situation était particulièrement défavorable. Il s’y trouvait trois batteries de DCA et quelques services allemands : un officier de garnison, l’important service des transports maritimes, le chef du ravitaillement de la Wehrmacht et quelques petites unités administratives. Un bataillon allemand arrivé en renfort dut être immédiatement employé pour moitié à la garde des dépôts. Cela libérait quelques équipes de servants pour les batteries côtières, que j’avais l’intention d’engager à la place du personnel italien, en cas de déroulement favorable à Bastia et à Bonifacio. D’ailleurs, il y avait à Bastia même et dans ses environs immédiats l’une des quatre divisions italiennes !
LA DÉFECTION DE L’ITALIE
Vingt-quatre heures après mon arrivée, la situation changea. Badoglio avait conclu un armistice avec le haut commandement allié. Les forces italiennes de l’île étaient neutralisées. Aussitôt, les mouvements de résistance français entrèrent en action. Le général Magli prétendait n’avoir pas d’ordres. Il s’offrit à contenir le commandement allemand dans la mesure du possible, à faciliter le transfert des forces allemandes de Sardaigne, à mater la rébellion des bandes armées françaises, à faire riposter par ses batteries côtières à tout tir provenant de la mer, et à continuer à laisser à ma disposition son service des transmissions. Il ne pouvait évidemment pas être question, dans les circonstances présentes, de procéder au désarmement des forces italiennes, comme l’avait ordonné OBS en prévision de ce cas. Les seules forces allemandes disponibles – la brigade SS – au reçu du mot-code « Axe », s’installèrent en tête de pont à Bonifacio afin de couvrir la retraite des forces allemandes de Sardaigne et leur jonction vers celles de Corse. Cette brigade était donc liée. La convention conclue par la voie diplomatique, et qui m’était indispensable pour poursuivre toute action de ma propre initiative, fut sérieusement compromise. Le 8 septembre au soir, la faible garnison de la marine de Bastia, sur ordre donné par les autorités maritimes et à mon insu, entreprit un coup de main sur le port de Bastia et les bâtiments italiens qui y étaient ancrés. Le coup de main échoua devant la résistance des Italiens, supérieurs en nombre. Il y eut de lourdes pertes des deux côtés, ainsi que des prisonniers. L’entreprise était insensée et contraire à nos propres intérêts. Il fallut m’efforcer de tenir en haleine le commandant en chef des forces italiennes jusqu’à l’arrivée de Sardaigne de renforts notables de la 90ème division de grenadiers blindés, afin de lui présenter alors mes revendications sous forme d’ultimatum. C’est pourquoi, après des pourparlers réciproques à Bastia, le statu quo fut rétabli le 9 septembre. Je n’assistais pas moi-même aux négociations, étant tombé dans une embuscade pendant mon voyage à Bastia. La voiture de tête de mon convoi fut victime de cette embuscade tendue par des résistants français. Le 12 septembre, les premiers éléments de la 90e division de grenadiers blindés arrivaient à Bonifacio. Le soir même, la situation s’aggrava du fait des actions de désarmement entreprises sur le continent italien par la Wehrmacht contre ses anciens alliés. Le général Magli se rendit compte du danger qui le menaçait et de l’impossibilité où il se trouvait de continuer à collaborer avec les Allemands, même comme « neutre ». Nous eûmes une entrevue très dramatique, au cours de laquelle il accepta, à ma grande surprise, de faire servir ses batteries côtières par des commandos allemands. Il fut d’accord pour rassembler ses troupes au centre de l’île et pour s’abstenir de tout acte d’hostilité. Par contre, il refusa d’évacuer Bastia en invoquant comme prétexte qu’il devait maintenir une liaison avec le continent. Je me réservai formellement toutes mesures qui pourraient devenir nécessaires pour la défense de l’île, notamment les mouvements de troupes. Il devenait évident que la situation à Bastia ne pourrait être assainie que par la force des armes.
J’INSTALLE MON PC À GHISONACCIA
 Dans mon bivouac situé tout près de Corte, j’étais sans défense et aurais pu facilement être arrêté par les Italiens. Aussi décrochai-je de nuit pour aller occuper un PC à Ghisonaccia, d’où je pourrais diriger la lutte sur la côte Est de l’île. Le chef du IIème corps aérien, venant de Sardaigne y était arrivé entre-temps. La situation exigeait la prise de Bastia. Les divisions italiennes ne se laisseraient pas désarmer par une division allemande. Encore bien moins arriverions nous à désarmer les résistants français. Leur nombre n’était pas connu, mais il existait des preuves indiscutables de leur fanatisme. La situation continuerait à demeurer critique même si des sûretés étaient alignées tout au long des cent soixante kilomètres de la route Est et si Bastia était prise. En cas de débarquement, les forces allemandes largement éparpillées sur la côte orientale présenteraient leurs flancs droit et gauche très étirés et découverts. Le transfert de la 90ème division de grenadiers blindés fut différé du fait que la situation dans l’île de Maddalena ne put pas être clarifiée. Une tentative de conquête de l’île échoua. La route maritime de la Sardaigne à la Corse se trouvait à portée de ses canons. Cependant, le général Lungershausen, commandant la 90′ division de grenadiers blindés, réussit à obtenir, grâce aux relations qu’il avait entretenues jusque-là avec le commandant en chef italien [Basso], que les troupes italiennes de Sardaigne demeurassent l’arme au pied pendant qu’il évacuerait cette île (le général Basso fut traduit plus tard devant un tribunal pour ce motif, mais fut acquitté). Cependant, en Sardaigne, les Italiens se trouvaient sur leur propre territoire, ce qui n’était pas le cas en Corse. Ils ne furent pas désarmés, comme leurs camarades du continent, et n’eurent donc pas à se considérer comme déshonorés. Mais ils n’avaient pas non plus à se défendre contre des résistants, comme les Italiens de Corse, qui eurent sans doute à subir bientôt la pression de commissaires alliés et n’étaient donc plus maîtres de leurs décisions. Avant le 13 septembre, il était impossible de rassembler des forces suffisantes pour réussir un coup de main sur Bastia tout en assurant la sécurité de la route de repli vers l’Ouest. Jusque-là, il fallait tenir les Italiens en haleine; ils devaient croire que nous n’envisagions qu’un départ de l’île analogue à notre retraite de Sardaigne. Ce mélange de ruses, de négociations traînées en longueur et de mouvements préparatoires fut encore compliqué par le caractère hétérogène de la garnison allemande de l’île. Quant à l’attitude loyale des troupes de l’armée de terre qui devaient venir en renfort, il n’y avait aucun doute possible. Par contre, les troupes stationnées en Corse me paraissaient moins sûres. Les vingt-quatre heures que j’y avais passées avant la capitulation italienne ne m’avaient pas suffi pour prendre en main les différents éléments de la Wehrmacht. La preuve en était le coup de main malheureux de la Marine. Mais les unités de la Luftwaffe ne paraissaient guère disposées non plus à se soumettre au commandement unique, pourtant indispensable et urgent. Le chef des aviateurs, un jeune colonel de vingt ans mon cadet, guerroyait pour son propre compte et m’accusait de « faiblesse dans le commandement ». Heureusement, il ne tarda pas à être rappelé sur le continent. Il abandonna la difficile organisation des évacuations aériennes à son chef du ravitaillement, d’ailleurs un collaborateur loyal. Toute différente fut l’attitude de la brigade SS. Cette troupe placée en dehors de la hiérarchie militaire, donc au fond simplement alliée, fit preuve – comme d’ailleurs d’autres unités de SS que j’avais connues en Russie – de la plus entière correction à l’égard des autorités supérieures de l’Armée. Les officiers supérieurs de l’Armée n’ignoraient évidemment pas la hiérarchie directe qui reliait ces unités à leurs chefs du Parti et leur indépendance, qui en résultait, pour tout ce qui concernait les questions de personnel et d’organisation. Mais je dois leur rendre cette justice que tous les officiers des Waffen-SS avec lesquels j ‘ai eu affaire, se sont toujours montrés corrects et modestes. Que, par ailleurs, ils aient constamment envoyé des rapports sur les officiers supérieurs de l’Armée – notamment en ce qui concerne le degré de confiance à leur accorder du point de vue politique – c’est plus que probable.
Dans mon bivouac situé tout près de Corte, j’étais sans défense et aurais pu facilement être arrêté par les Italiens. Aussi décrochai-je de nuit pour aller occuper un PC à Ghisonaccia, d’où je pourrais diriger la lutte sur la côte Est de l’île. Le chef du IIème corps aérien, venant de Sardaigne y était arrivé entre-temps. La situation exigeait la prise de Bastia. Les divisions italiennes ne se laisseraient pas désarmer par une division allemande. Encore bien moins arriverions nous à désarmer les résistants français. Leur nombre n’était pas connu, mais il existait des preuves indiscutables de leur fanatisme. La situation continuerait à demeurer critique même si des sûretés étaient alignées tout au long des cent soixante kilomètres de la route Est et si Bastia était prise. En cas de débarquement, les forces allemandes largement éparpillées sur la côte orientale présenteraient leurs flancs droit et gauche très étirés et découverts. Le transfert de la 90ème division de grenadiers blindés fut différé du fait que la situation dans l’île de Maddalena ne put pas être clarifiée. Une tentative de conquête de l’île échoua. La route maritime de la Sardaigne à la Corse se trouvait à portée de ses canons. Cependant, le général Lungershausen, commandant la 90′ division de grenadiers blindés, réussit à obtenir, grâce aux relations qu’il avait entretenues jusque-là avec le commandant en chef italien [Basso], que les troupes italiennes de Sardaigne demeurassent l’arme au pied pendant qu’il évacuerait cette île (le général Basso fut traduit plus tard devant un tribunal pour ce motif, mais fut acquitté). Cependant, en Sardaigne, les Italiens se trouvaient sur leur propre territoire, ce qui n’était pas le cas en Corse. Ils ne furent pas désarmés, comme leurs camarades du continent, et n’eurent donc pas à se considérer comme déshonorés. Mais ils n’avaient pas non plus à se défendre contre des résistants, comme les Italiens de Corse, qui eurent sans doute à subir bientôt la pression de commissaires alliés et n’étaient donc plus maîtres de leurs décisions. Avant le 13 septembre, il était impossible de rassembler des forces suffisantes pour réussir un coup de main sur Bastia tout en assurant la sécurité de la route de repli vers l’Ouest. Jusque-là, il fallait tenir les Italiens en haleine; ils devaient croire que nous n’envisagions qu’un départ de l’île analogue à notre retraite de Sardaigne. Ce mélange de ruses, de négociations traînées en longueur et de mouvements préparatoires fut encore compliqué par le caractère hétérogène de la garnison allemande de l’île. Quant à l’attitude loyale des troupes de l’armée de terre qui devaient venir en renfort, il n’y avait aucun doute possible. Par contre, les troupes stationnées en Corse me paraissaient moins sûres. Les vingt-quatre heures que j’y avais passées avant la capitulation italienne ne m’avaient pas suffi pour prendre en main les différents éléments de la Wehrmacht. La preuve en était le coup de main malheureux de la Marine. Mais les unités de la Luftwaffe ne paraissaient guère disposées non plus à se soumettre au commandement unique, pourtant indispensable et urgent. Le chef des aviateurs, un jeune colonel de vingt ans mon cadet, guerroyait pour son propre compte et m’accusait de « faiblesse dans le commandement ». Heureusement, il ne tarda pas à être rappelé sur le continent. Il abandonna la difficile organisation des évacuations aériennes à son chef du ravitaillement, d’ailleurs un collaborateur loyal. Toute différente fut l’attitude de la brigade SS. Cette troupe placée en dehors de la hiérarchie militaire, donc au fond simplement alliée, fit preuve – comme d’ailleurs d’autres unités de SS que j’avais connues en Russie – de la plus entière correction à l’égard des autorités supérieures de l’Armée. Les officiers supérieurs de l’Armée n’ignoraient évidemment pas la hiérarchie directe qui reliait ces unités à leurs chefs du Parti et leur indépendance, qui en résultait, pour tout ce qui concernait les questions de personnel et d’organisation. Mais je dois leur rendre cette justice que tous les officiers des Waffen-SS avec lesquels j ‘ai eu affaire, se sont toujours montrés corrects et modestes. Que, par ailleurs, ils aient constamment envoyé des rapports sur les officiers supérieurs de l’Armée – notamment en ce qui concerne le degré de confiance à leur accorder du point de vue politique – c’est plus que probable.
JE REPRENDS BASTIA
 Le 11 septembre, certaines autorités locales tentèrent une nouvelle fois d’obtenir, par des négociations, l’évacuation de Bastia. La tentative échoua. Les faibles forces allemandes en furent donc retirées, pour ne pas gêner l’attaque de la brigade SS qui arrivait progressivement.
Le 11 septembre, certaines autorités locales tentèrent une nouvelle fois d’obtenir, par des négociations, l’évacuation de Bastia. La tentative échoua. Les faibles forces allemandes en furent donc retirées, pour ne pas gêner l’attaque de la brigade SS qui arrivait progressivement.
Le 12 septembre, je fis porter au général Magli, par un parlementaire, un télégramme du feld-maréchal Kesselring qui l’invitait encore une fois à collaborer, après s’être référé à leur longue coopération de plusieurs années et à sa haute estime personnelle. Je trouvai plus judicieux de mettre en même temps Magli en demeure d’évacuer Bastia et d’autres localités qui m’étaient nécessaires pour la défense de l’île, sous peine de me voir recourir à l’emploi de la force. Le général Magli répondit par une lettre pleine d’échappatoires et d’accusations.
À la suite de quoi je donnai l’ordre de désarmer toutes les unités italiennes rencontrées dans les secteurs de mes troupes. Il ne pouvait s’agir que d’unités qui n’avaient pas exécuté les accords conclus et ne s’étaient pas retirées à l’intérieur de l’île, sans doute parce qu’elles préféraient la captivité allemande à la française. Les éléments de la brigade SS dirigés sur Bastia brisèrent ce jour-là quelques résistances italiennes à Casamozza et atteignirent leur point de rassemblement au Sud de Bastia. Les Italiens réussirent à faire sauter un grand pont routier à Casamozza, après le passage des troupes allemandes. Ceci rendit l’approche plus difficile et plus lente. Mais un pont de chemin de fer situé à l’Est put être rapidement aménagé pour le trafic routier.
Je fixai au 13 septembre l’attaque de Bastia. Celle-ci ne progressa que lentement, l’adversaire tenant la route d’accès située en contrebas sous le feu nourri de nombreuses batteries habilement dissimulées sur les hauteurs au sud-ouest de Bastia. Je jetai moi-même un coup d’œil sur les difficultés résultant du terrain. Ce qui était particulièrement troublant, c’était le duel que se livraient les batteries de DCA allemandes et italiennes à des distances parfois très réduites. Je ne vis de possibilité de succès que dans une attaque de nuit, que j’organisai dans le détail, et vers vingt heures, la tête de la brigade SS pénétra dans la ville. Seuls, les éléments de la division italienne qui ne se battaient plus que pour la forme furent faits prisonniers. Les autres se replièrent dans les montagnes vers le Sud-Ouest.
Le 14 septembre, j’étais à Bastia pour y mettre sur pied la formation d’une tête de pont. Je manquais d’infanterie et dus renoncer à prendre possession de la presqu’île faisant saillie vers le Nord. Le peu que j’avais en aurait été encore plus dispersé. Quand je regagnai mon PC, le soir, heureux de la prise de Bastia et du retrait des Italiens vers l’intérieur de l’île, je trouvai mon officier d’état-major désespéré par les ordres qui venaient d’arriver. Sur l’ordre de Hitler, tous les officiers italiens devaient être fusillés, et les noms communiqués avant la fin de la journée. Cet ordre avait été donné en exécution d’une directive générale de l’OKVV, aux termes de laquelle tous les officiers italiens faits prisonniers après le 10 septembre, s’ils avaient combattu après cette date, devaient être considérés comme francs-tireurs et passés par les armes. Les officiers italiens avaient obéi à leur gouvernement légitime. La plupart des quelque deux cents officiers prisonniers avaient préféré la captivité allemande à leur remise, au moins temporaire, aux forces françaises. Ils espéraient pouvoir de cette façon rentrer en Italie plus vite. Par ailleurs, ils avaient des amis parmi leurs anciens alliés, qui les accueillirent cordialement. J’eus alors très nettement conscience que le moment était venu où il me faudrait refuser obéissance. J’appelai aussitôt le feld-maréchal Kesselring par téléphonie sans fil (sur ondes décimétriques) et l’informai que je refusais d’exécuter cet ordre.
RECONQUÉRIR L’ILE PUIS L’ÉVACUER !
Le feld-maréchal écouta mon compte rendu sans commentaire et promit de le transmettre à l’OKVV Je fis le nécessaire pour évacuer les officiers prisonniers sur le continent, où l’ordre de les fusiller ne devait pas être connu. Je suis reconnaissant au feld-maréchal Kesselring d’avoir accepté en quelque sorte mon refus d’obéissance, sans en tirer aucune conséquence. La situation dans l’île était modifiée, à la suite des nouvelles instructions. Le chef de l’état-major OBS avait apporté, le 13 septembre, la directive de ne pas défendre l’île, mais de transférer toutes les forces allemandes sur le continent. Ceci ne rendait pas inutile la prise de Bastia. Du moins n’aurais-je plus à me soucier de soumettre l’île. L’évacuation des 30.000 hommes – dont deux tiers de l’armée de terre et un tiers de la Luftwaffe – ne pouvait se faire que par voie aérienne, au départ des deux aérodromes de Ghisonaccia et de Borgo-Bastia. La longue route orientale serait à évacuer progressivement tout en se défendant face à l’Ouest. Les contingents furent fixés à 3.000 hommes par jour. En même temps qu’ils étaient rassemblés, il fallut élargir la tête de pont de Bastia tout en continuant à assurer la sécurité de la route orientale.
Ceci entraînait une telle dispersion des forces d’infanterie que l’engagement d’actions offensives en direction du massif montagneux central devenait impensable. Même de simples coups de main contre les dépôts d’approvisionnement de Ghisoni et de Quenza, à l’intérieur de l’île, qui étaient tombés aux mains de l’ennemi, échouèrent. Il apparaît ici, encore plus nettement qu’en Sicile, que, sur les routes de montagne, les chars pouvaient être très facilement repoussés, et liquidés dans des guet-apens. Quoique la situation exigeât de concentrer toutes nos forces sur l’évacuation et la sauvegarde des hommes et du matériel, le chef de l’état-major du groupe d’armées, le général Westphal, apporta, le 16 septembre, l’ordre de l’OBS d’enlever la route de montagne qui traversait l’île du Nord au Sud et le long de laquelle l’adversaire se rassemblait, et en somme, de reconquérir l’île avant de l’évacuer. Le général Westphal était un officier d’état-major trop avisé pour ne pas se rendre compte du caractère insensé de cet ordre. Il approuva mon point de vue, que je lui exposai très énergiquement, et le défendit à son retour à l’OBS, qui me donna son accord dans la soirée. Le 19 septembre, le feld-maréchal Kesselring, qui ne craignait pas de s’exposer, arriva lui-même dans l’île et donna ses directives pour l’évacuation ultérieure.
LES DEUX DERNIÈRES SEMAINES
Les premiers jours, l’évacuation se déroula conformément aux plans. La troupe fut évacuée par air au départ des terrains de Ghisonaccia et de Borgo-Bastia, le matériel par mer via Bastia. Le 20 septembre, l’ennemi devint plus actif, tant à terre que sur mer et dans les airs. L’évacuation se poursuivit cependant, mais les liaisons de l’île avec le continent furent de plus en plus menacées et interrompues. Sur terre, les troupes régulières du général Giraud – que nous prenions alors pour des troupes gaullistes – lancèrent des attaques à partir d’Ajaccio où elles avaient débarqué. Il s’agissait surtout de Marocains et de Sénégalais, de la force de vingt-trois bataillons, d’après les déclarations des prisonniers. Ils étaient soutenus par des chars américains. Le matériel et les bêtes de somme nécessaires pour la guerre de montagne, cet adversaire les trouva auprès des troupes de Badoglio. Ainsi l’adversaire se trouvait en mesure de contourner les sûretés allemandes par les sentiers de montagne, de les couper en partie sans qu’on pût les secourir, et, pour finir, de pousser jusqu’à l’artère vitale des troupes allemandes. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, mon PC de Bastia fut menacé. Mais je pus encore exécuter des contre-attaques au départ de la tête de pont, car, au fur et à mesure de la diminution de nos forces, le front à défendre se rétrécissait. Ainsi l’adversaire perdit encore quelques centaines de prisonniers. Nous avions fait sauter toutes les routes conduisant vers la zone occupée par nos troupes, si bien que l’ennemi ne put y amener ni artillerie ni chars. Le 21 septembre, l’ennemi avait attaqué le port et la ville de Bastia avec 21 « Liberators », et coulé les navires « Tiberiade », « Nikolaus », et deux autres bâtiments plus petits destinés au transport du matériel spécial. Au cours de la nuit suivante, le port fut attaqué par 12 « Wellington ». Deux bacs furent coulés. Le 29 septembre, 36 « Liberators » attaquèrent l’aérodrome de Borgo et le rendirent impraticable. Mais les fortes batteries de DCA de 88 millimètres, rassemblées sur un espace étroit, réussirent à disperser l’escadre de telle sorte qu’elle n’obtînt pas de résultat parfait. Le soir même, le terrain était remis en état. Les transports aériens subissaient de lourdes pertes. Dans la seule journée du 25 septembre, 11 « Junkers » (avions de transport) furent abattus au dessus de la mer. Le 24 septembre, des sous-marins ennemis avaient torpillé le paquebot « Champagne » dans le port même de Bastia. Il put être remis à flot. Il reprit la mer le 27 septembre, reçut deux torpilles à sa sortie du port et coula. Le 24 septembre, j’avais transféré mon PC de Ghisonaccia à la lisière Sud de Bastia. Là, je subis une légère attaque de paludisme. C’est de ma tente que je suivais les transports, les pertes en mer et les attaques sur mes derniers aérodromes provisoires. À ma grande joie, mon fidèle ami Rohr me fit la bonne surprise de me rendre visite. L’ordre de m’attendre sur le continent ne l’avait pas atteint, ou bien il l’avait ignoré, ce qui aurait assez bien répondu à son caractère. Ainsi il partagea avec moi les deux dernières semaines dans l’île. La tête après l’évacuation des derniers éléments de la 90e division de grenadiers blindés; Porto-Vecchio dans la nuit du 22 au 23 septembre, l’aérodrome de Ghisonaccia dans la nuit du 2 au 3 octobre. Les soixante ponts de la route orientale avaient été détruits. Les installations portuaires de Bonifacio et Porto-Vecchio avaient sauté. L’aérodrome de Ghisonaccia avait été rendu impraticable par explosifs. Au terrain d’aviation de Borgo, qui n’était pas très bien équipé, s’ajoutait le terrain auxiliaire de Poretta. Vers la fin, à cause des pertes, les transports aériens ne se firent plus que de nuit. Quand ces deux terrains eurent été abandonnés à leur tour, le reste de la tête de pont de Bastia – moi compris – devint tributaire du seul transport maritime. Mais même les bateaux, du fait des sous-marins aux aguets, ne pouvaient plus circuler. Nous en étions réduits aux pontons plats et aux bacs « Siebel ». Cependant, le transport maritime au moyen de ces bateaux plats devenait de plus en plus problématique, du fait des tempêtes d’automne qui commençaient à sévir. Ils ne tenaient pas bien la mer et durent souvent faire demi-tour. Nous nous demandions chaque jour avec angoisse si notre flotte de bâtiments de transport allait enfin faire son apparition. Après l’évacuation des derniers terrains d’aviation, le 2 octobre, je rendis compte que la tête de pont ne pourrait plus être tenue que jusqu’à la nuit du 3 au 4 octobre. Ceci entraînait la perte de quelques centaines de camions. Les derniers bacs « Siebel » durent transporter un certain nombre de batteries de DCA, qui avaient été indispensables jusque-là pour la défense de la tête de pont. Elles furent chargées en dehors du port, car l’adversaire avait resserré son étreinte sur la tête de pont contre nos forces d’infanterie décroissantes, et pouvait rendre le port sous ses feux.
LA SCÈNE DE BATAILLE LA PLUS PITTORESQUE
 La lutte approchait de son issue dramatique. Nous étions pratiquement encerclés: sur terre par les troupes françaises et les résistants, qui se rapprochaient de plus en plus, sur mer par les sous-marins, et dans les airs par l’indiscutable supériorité des forces aériennes alliées. Je transportai mon PC, pendant la dernière nuit, de Bastia vers le Nord, car l’ennemi menaçait de faire irruption des hauteurs qui entourent Bastia en amphithéâtre. La flotte des bâtiments de transport était arrivée et chargeait, dans le port et en dehors, les derniers canons d’assaut, les derniers chars et les dernières pièces d’artillerie. Quelqu’un eut l’idée d’incendier les camions qu’il fallait abandonner. L’incendie gagna le port, menaça les quais et dut être combattu par bateaux. La tension croissait. Nous dûmes assister les bras croisés à l’explosion de nos munitions. Pour me changer les idées et me détendre, je décidai d’aller prendre un bain de mer. Rohr, pendant ce temps, s’entretenait avec une jolie Française qui travaillait comme infirmière à l’hôpital. Vers seize heures, je montai dans une embarcation qu’on avait tirée sur la rive, afin de diriger en mer les derniers chargements et de visiter les divers embarcadères. La barque surchargée n’arrivait pas très bien à se mettre à flot, et tout autour giclaient les geysers produits par les obus qui explosaient dans l’eau. Plus au large, je grimpai sur une vedette rapide, mais, à ce moment, on s’aperçut qu’on manquait de ceintures de sauvetage. Donc, retour au port en ébullition où nous récupérâmes des ceintures de sauvetage sur un paquebot torpillé. Les batteries de DCA, qui n’étaient heureusement pas engagées contre l’aviation, tiraient sans répit sur les hauteurs. Elles avaient des munitions en excédent, puisqu’on ne pouvait pas les emporter. Ce fut, au fond, notre salut. Quand il fallut les embarquer à leur tour, il n’y eut plus que les bateaux et les pontons qui tiraient en direction des hauteurs disparaissant progressivement dans le crépuscule.
La lutte approchait de son issue dramatique. Nous étions pratiquement encerclés: sur terre par les troupes françaises et les résistants, qui se rapprochaient de plus en plus, sur mer par les sous-marins, et dans les airs par l’indiscutable supériorité des forces aériennes alliées. Je transportai mon PC, pendant la dernière nuit, de Bastia vers le Nord, car l’ennemi menaçait de faire irruption des hauteurs qui entourent Bastia en amphithéâtre. La flotte des bâtiments de transport était arrivée et chargeait, dans le port et en dehors, les derniers canons d’assaut, les derniers chars et les dernières pièces d’artillerie. Quelqu’un eut l’idée d’incendier les camions qu’il fallait abandonner. L’incendie gagna le port, menaça les quais et dut être combattu par bateaux. La tension croissait. Nous dûmes assister les bras croisés à l’explosion de nos munitions. Pour me changer les idées et me détendre, je décidai d’aller prendre un bain de mer. Rohr, pendant ce temps, s’entretenait avec une jolie Française qui travaillait comme infirmière à l’hôpital. Vers seize heures, je montai dans une embarcation qu’on avait tirée sur la rive, afin de diriger en mer les derniers chargements et de visiter les divers embarcadères. La barque surchargée n’arrivait pas très bien à se mettre à flot, et tout autour giclaient les geysers produits par les obus qui explosaient dans l’eau. Plus au large, je grimpai sur une vedette rapide, mais, à ce moment, on s’aperçut qu’on manquait de ceintures de sauvetage. Donc, retour au port en ébullition où nous récupérâmes des ceintures de sauvetage sur un paquebot torpillé. Les batteries de DCA, qui n’étaient heureusement pas engagées contre l’aviation, tiraient sans répit sur les hauteurs. Elles avaient des munitions en excédent, puisqu’on ne pouvait pas les emporter. Ce fut, au fond, notre salut. Quand il fallut les embarquer à leur tour, il n’y eut plus que les bateaux et les pontons qui tiraient en direction des hauteurs disparaissant progressivement dans le crépuscule.
Je n’ai pas vu, tout au long de cette guerre, de scène de bataille plus pittoresque. Dans le port et entre les bateaux s’élevaient les geysers soulevés par l’explosion des obus. Les balles traceuses de nos pièces de DCA dessinaient de longues traînées lumineuses au-dessus de la ville et des terrains avoisinants. Tandis que les arrière-gardes embarquaient, les destructions préparées à l’avance dans le secteur urbain sautaient. Puis, ce fut l’obscurité; le bruit s’éteignit; un silence oppressant s’installa. On n’entendait même plus le glissement sur l’eau des bateaux qui prenaient le large. Impossible de voir comment se passaient les embarquements; je doutais encore qu’ils pussent vraiment réussir. Je me fis à nouveau conduire près de la rive, afin de me rendre compte de ce qu’il était advenu des derniers bateaux et des troupes du dernier échelon. Les officiers de mon entourage commençaient à s’impatienter. Enfin, je reçus le message d’un officier de marine me rendant compte que le commandant de l’arrière-garde avait tout embarqué et se trouvait déjà en route vers le continent. Je demeurai encore un moment auprès de l’embarcadère, afin d’emmener d’éventuels retardataires. À 23 h [le 3 octobre] je donnai enfin l’ordre qui nous soulagea tous : « En avant toute ! « . Nous prîmes la direction plein Nord, pour éviter les sous-marins. Je m’enveloppai dans mon manteau et m’étendis sur le pont, levai les yeux vers les étoiles et sombrai aussitôt dans un profond sommeil. Je ne fus réveillé qu’à l’aube, par le bruit. Le bateau était arrêté. Nous avions atteint le port de Livourne. Les officiers de marine qui avaient dirigé le transport et attendu notre arrivée toute la nuit ne nous lâchèrent pas tout de suite. Il fallut tout d’abord fêter avec eux notre arrivée (…)
Le communiqué de la Wehrmacht avait dû rassurer ma famille sur mon sort. Il avait insisté tout particulièrement sur l’évacuation de la Corse, ce qui me rassura à mon tour, d’autant plus que je reçus un télégramme de Hitler, me félicitant pour la manière dont j’avais dirigé une opération « dont on n’avait pas osé espérer une réussite aussi parfaite ». J’appris plus tard qu’il y avait eu des discussions à mon sujet à l’OKVV, dans lesquelles mes partisans eurent le dessus. Mais mon refus d’obéissance [pour fusiller les officiers italiens] m’avait fait inscrire sur certaine liste noire. Jusqu’au 10 octobre, je me reposai dans la villa Pozzo, rendant chaque jour visite à mon fils, qui attendait à Lucca sa mutation pour la Russie. Le 11 octobre, je me rendis au quartier général du feld-maréchal Kesselring sur le Monte Soracte. Là, je fus mis un peu au courant de ce qui s’était passé sur le continent. Kesselring m’avait dit lors de sa dernière visite qu’il espérait voir l’ennemi débarquer, non pas en Corse, mais sur le continent. Là, il disposerait de suffisamment de troupes pour le rejeter à la mer. Ses espoirs s’étaient révélés fallacieux. L’adversaire avait réussi son débarquement à Salerne. Néanmoins, c’était un grand succès pour nous d’avoir pu conserver Rome.
Général von SENGER und ETTERLIN
(1) L’Oberkommando der Wehrmacht (OKW) était l’organe de commandement suprême des forces armées allemandes de 1938 à 1945
Lien : Le col des goumiers
Lien : La libération de Bastia
Lien : Libération de la Corse
Lien : Les combats de la libération